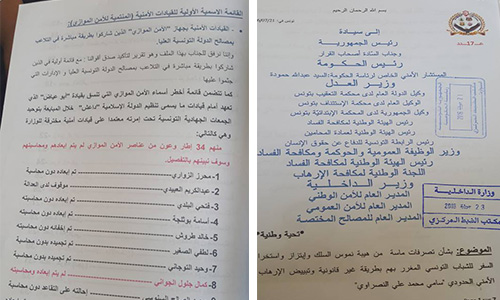Dans les pays du Maghreb, de plus en plus, des islamistes tentent d'imposer leurs signes et leurs normes dans l'espace scolaire. Pour se défendre, les écoles doivent se doter d'un règlement clair, estime Habib Kazdaghli, le doyen de l'université de la Manouba, en Tunisie.
En 2012, il a failli aller en prison en raison de son combat contre l’emprise des salafistes sur son université. Habib Kazdaghli, doyen de la faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba (Flahm), est une des figures de la lutte contre le salafisme en Tunisie. Il s’en est fallu de peu que son université devienne un « Manoubistan ». Aujourd’hui, le conservatisme gagne de plus en plus les écoles dans les pays du Maghreb. À l’occasion de chaque rentrée scolaire, les islamistes s’attaquent aux programmes scolaires et aux enseignants qui ne sont pas à leur goût.
Il en est allé ainsi, le vendredi 15 septembre dans la ville de Sfax, lorsqu’un groupe de parents d’élèves a humilié une enseignante, l’accusant de mécréance. Ou encore en Algérie, où la ministre de l’Éducation nationale, Nouria Benghebrit, a une nouvelle fois croisé le fer avec les conservateurs au sujet de la disparition d’une formule islamique dans certains livres scolaires (« Bismillah », « au nom d’Allah »). Au Maroc, même si le roi reste un rempart contre les islamistes, une polémique avait éclaté l’année dernière sur la réforme des manuels de philosophie et d’éducation islamique.
Dans cette interview, Habib Kazdaghli la façon dont le champ de bataille des islamistes s’est déplacé à l’école.
Jeune Afrique : Quelle est votre réaction après l’humiliation subie par votre collègue de la ville de Sfax qu’on a accusée de mécréance ?
Habib Kazdaghli : En tant que défenseur de l’école républicaine, je condamne fermement ce qui lui ai arrivé. Ces actes doivent être bannis dans un établissement scolaire. Les parents d’élèves n’avaient pas le droit de s’attaquer directement à cette enseignante. Ce que j’ai trouvé regrettable, c’est que le délégué régional de l’Éducation ait demandé à cette dernière, sous prétexte de la protéger, de formuler par écrit sa demande de mutation. Il lui a dit que que si elle refusait, il allait tenir un conseil pour l’obliger de partir. Heureusement que la réaction de sa hiérarchie au ministère de l’Éducation nationale a été positive, en dépêchant une commission d’enquête sur les lieux.
En 2012, vous avez vécu la même humiliation au sein de votre universitélorsque des salafistes ont voulu imposer le voile intégral (niqab). Que retenez-vous de cette expérience ?
À l’époque, les habitants des quartiers avoisinants avaient déferlé sur l’université pour me faire dégager de mon poste. Ils disaient que je n’avais pas respecté ce que les salafistes voulaient imposer, c’est-à-dire l’ouverture d’une salle de prière dans l’établissement et l’obligation du port du niqab pour les filles. Le ministre de de tutelle (dans le gouvernement de l’islamiste Hamadi Jebali) n’avait pas défendu notre université. Heureusement que la société civile s’était mobilisée.
Les valeurs d’égalité ne sont jamais acquises dans une société. Il faut continuer à les défendre
La Tunisie est loin d’être le seul pays où les islamistes s’en sont pris à l’enseignement. Les mêmes assauts se produisent actuellement en Algérie et au Maroc. Pensez-vous que l’école est en danger dans ces pays ?
Même les pays développés ne sont pas à l’abri. Depuis la nuit des temps, la religion a guidé la vie des hommes. C’est pourquoi la société civile doit être vigilante pour veiller au respect des lois. Il peut y avoir instrumentalisation de l’école par le religieux et le politique. En tant qu’enseignants, notre devoir est de respecter les exigences pédagogiques. La religion a ses lieux de culte. Elle ne se pratique pas à l’école.
Plus que la société civile, n’est-ce pas avant tout la responsabilité de l’État ?
Incontestablement, car ces groupes islamises, d’une façon ou d’une autre, cherchent à détruire sa légitimité. Rappelez-vous le cas du parti Ennahdha. Même s’il a adhéré à la Constitution tunisienne d’aujourd’hui, il avait tout fait pour qu’elle soit inspirée de la Charia. Il voulait revenir sur l’égalité hommes-femme. On pensait que ces valeurs d’égalité étaient consacrées dans la société tunisienne. Il s’est avéré que non. Elles ont été dictées par un homme éclairé (Habib Bourguiba, ndlr) à un moment donné. Mais elles ne sont pas acquises. Il faut que la société se mobilise pour défendre les idées de la lumière.
Les islamistes veulent une école au service de l’embrigadement
Au Maroc, en Algérie et en Tunisie, on a l’impression que le champ de bataille entre l’État et les islamistes s’est déplacé au niveau de l’école. Confirmez-vous ce ressenti ?
C’est normal. L’école est le symbole de la modernité, la source de l’unité de la société et des générations futures. On veut que l’école soit détournée de son rôle et de « sa matière grise », comme disait Bourguiba. Il disait qu’en Tunisie, nous n’avions pas de matières premières mais une matière grise. Les écoles scientifiques étaient les premières à tomber dans l’escarcelle des islamistes parce que le contenu des programmes se base sur les sciences exactes alors que dans les facultés littéraires ou des sciences humaines, les élèves sont poussés au questionnement. Ils veulent une école au service de l’embrigadement. Pendant longtemps, sous les dictatures, nos universités étaient investies par la police. Lorsque ces dictatures ont été déchues, ce sont les islamistes qui ont pris la place de la police. Nous ne voulons ni les premiers, ni les seconds. L’école doit être guidée par ses seules valeurs académiques.
Cette poussée islamiste n’est-elle pas le résultat de la démission progressive des États maghrébins de la politique d’enseignement depuis les années 1970 ?
Les États ont failli à leur rôle alors qu’ils étaient en avance par rapport à la société. Après l’indépendance, il s’étaient donné pour mission de récupérer le retard accusé sous la colonisation. Mais quand ils ont commencé à s’enrichir, ils se sont trouvé des ennemis. Ils se sont mis à combattre les mouvements de gauche qui demandaient plus de réformes et de justice sociale. Alors, pour se protéger contre eux, ils ont utilisé les islamistes. Nous voulons que l’État revienne à sa mission de base. La politique et la religion n’ont pas à instrumentaliser l’école. Chacune à sa fonction et l’espace dans lequel elle doit exercer ses pouvoirs. Mais l’État, c’est aussi nous, les citoyens. Nous devons à l’école publique l’ouverture de nos esprits et l’ascension sociale. Il faut lui rendre ce que nous avons appris grâce à elle.
Les réformes engagées dans les écoles au Maghreb ont-elles provoqué la panique chez les islamises et les ont-elles poussés à attaquer ?
En Tunisie, il faut dire que ce genre d’attaque islamiste a diminué par rapport à la période 2011-2013, où on a même assisté à des assassinats. De temps en temps, il y a évidemment des répliques. Mais la lutte contre le conservatisme est de longue durée. Les forces obscurantistes ne peuvent être combattues que par la vigilance de tous.
Nous avons réussi à faire disparaître le niqab de l’université grâce à un règlement interne
Comment mener ce combat avec un corps enseignant qui, lui aussi, peut en partie être guidé par la pensée de ceux qui cherchent à imposer le religieux à l’école ?
Les enseignants sont à l’image de la société. C’est pourquoi nous devons préciser clairement et par des lois les missions d’une école. Ces missions ne sont ni religieuses, ni politiques. Concernant le port du niqab par exemple, il ne nous appartient pas d’interférer dans la liberté de celles qui le portent, mais il est de notre devoir de leur expliquer qu’il empêche l’exigence pédagogique. Il empêche la communication. À l’école, on ne cherche pas à respecter Dieu, on respecte le savoir.
Avez-vous vécu des exemples pareils dans votre université ?
Énormément. Nous avons réussi à convaincre beaucoup d’enseignantes qui débarquaient avec un niqab de l’enlever en leur expliquant qu’elles ne pouvaient pas accomplir leur rôle de pédagogue. En Arabie saoudite, dans les classes de filles, lorsqu’il n’y a pas d’enseignantes femmes, on les remplace par des enseignants hommes mais en les cloîtrant dans des box, de façon à ce qu’ils ne voient pas leurs étudiantes. C’est terrible.
Je n’ai pas voulu de ça dans mon université. C’est pourquoi notre conseil a voté un règlement qui interdit le niqab en cours. Quand une étudiante se présente sous cet accoutrement, l’enseignant lui dit qu’il n’est pas en situation pédagogique et qu’elle doit l’enlever en vertu du règlement interne. Si elle refuse, il est alors obligé d’arrêter le cours et d’écrire un rapport destiné à la direction. C’est ainsi que nous avons pu abolir le niqab dans notre université. Par simple application de la loi. Mais il faut bien qu’elle existe.
L’État peut s’affaiblir. Mais chaque corps doit continuer à défendre ses exigences
Pour combattre toute tentative rétrograde, il faut donc que les écoles établissent des lois strictes et claires…
C’est la seule solution. Notre règlement a été établi en juillet 2012. Les islamistes nous avaient accusés à l’époque d’avoir enfreint les libertés, alors que nous n’y avions pas touché. L’État peut s’affaiblir. C’est le cycle de l’Histoire. Mais chaque corps doit continuer à défendre ses exigences.
Que faire si l’État joue le jeu des islamistes ?
J’ai vécu cela en 2012 lorsque deux filles salafistes sont parties dire à la police que je les avais giflées. La police les a crues et j’ai été traduit devant un tribunal pour acte de violence pendant l’exercice de mes fonctions. Je risquais cinq ans de prison. Mais la société civile s’est mobilisée pour moi et j’ai été acquitté. La bataille contre le conservatisme doit continuer.